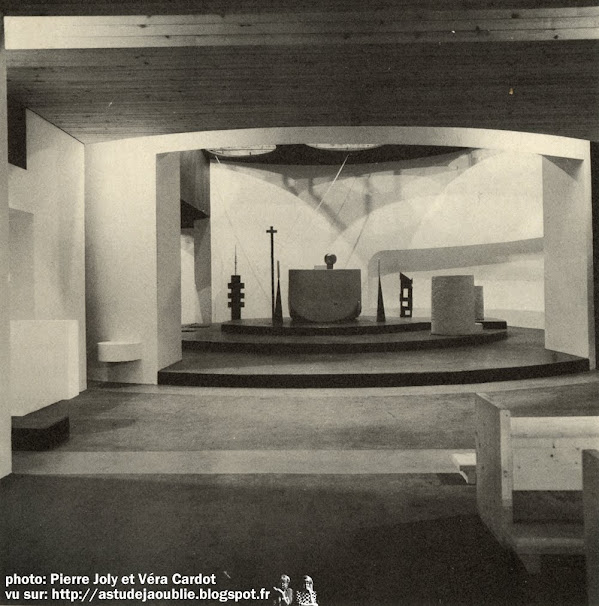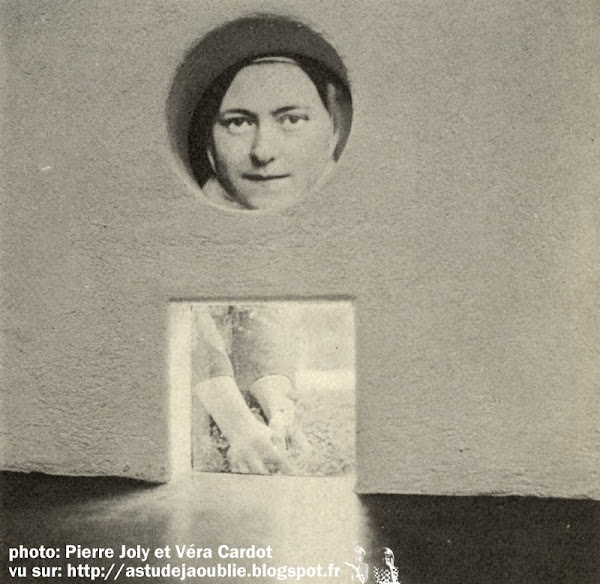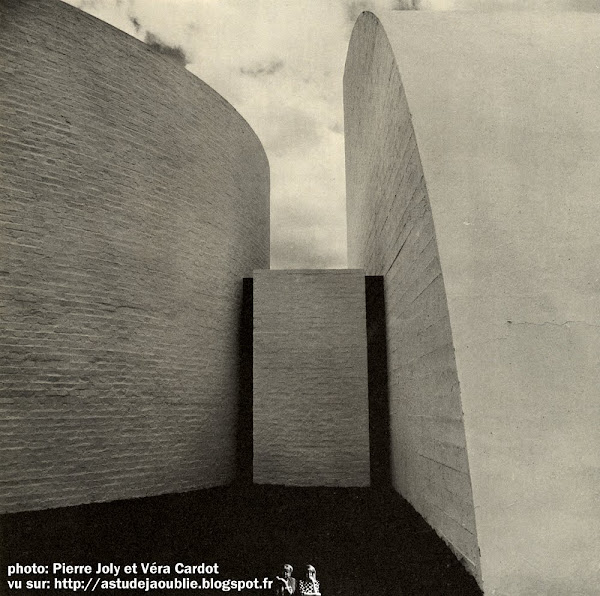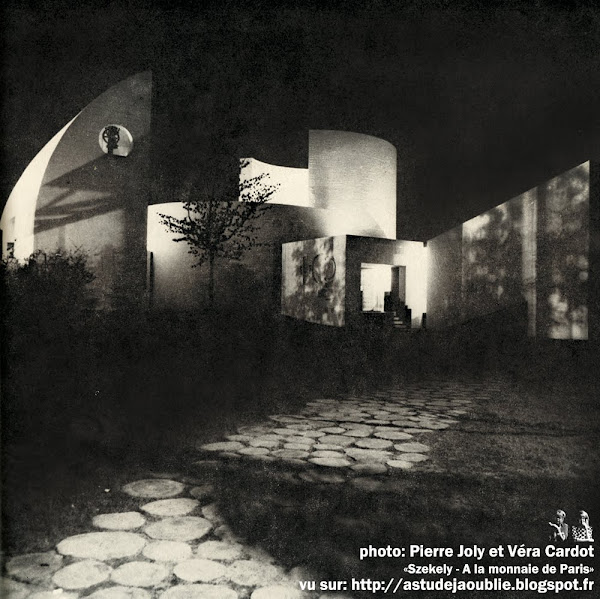Architectes: Pierre Székely et Claude Guislain
Construction: 1964-1966
"L'Architecture d'un sculpteur" - L'Oeil - 1966
La chapelle du carmel de Valenciennes, à Saint-Saulve, que Pierre Székély vient d’achever avec la collaboration de l'architecte Claude Guislain, apparaît comme l'œuvre d'un sculpteur: le traitement des volumes sans fenêtres, l'équilibre de l'ensemble, l’unité des surfaces, expriment une conception plastique déterminée. Pourtant, chacun des éléments de l'édifice répond très précisément à sa destination et au programme détaillé fixé par l'abbé Devred, représentant la communauté et Instigateur de l’entreprise. C’est lui en effet, qui, en 1963, demanda à Székély de concevoir la chapelle et de la réaliser en collaboration avec un architecte de la région. Celui-ci, de son côté, avait accepté dès le départ, le principe de construire un édifice élaboré dans ses formes mêmes par un sculpteur.
Quant aux religieuses, leur décision fut prise après une visite de la mère prieure à Ronchamp, où elle découvrit, avec une émotion extraordinaire, une forme d’architecture sacrée qu’elle ne soupçonnait pas.
Avant d’établir son projet, Székély a fait de longs séjours près du Carmel, pour connaître la règle, le rythme des journées, le déroulement des offices et comprendre le sens du cérémonial qui entoure chacun des actes de la vie conventuelle, centrée autour de la chapelle. Le sculpteur avait en effet obtenu les plus larges permissions pour pénétrer dans le monastère malgré la clôture.
Après cette période de préparation, Székély sculpta en 24 heures une maquette qui fut adoptée aussitôt. L’architecte entreprit alors l’étude et la mise au point des plans d’exécution. La chapelle et ses dépendances comprennent deux parties distinctes — l’une réservée aux religieuses, l'autre au public — disposées sur deux axes perpendiculaires convergeant vers l’autel. L’ensemble, dominé par le clocher et le mur courbe du sanctuaire, s'élève à peu de distance du monastère, auquel il sera relié par un cloître en cours de construction.
Photos Pierre Joly et Véra Cardot - L'Oeil - 1966
Vue d’ensemble de la chapelle et des bâtiments annexes.
Le haut mur courbe, au centre, est celui du sanctuaire. A gauche, la nef et la tribune réservées au public ; à droite le clocher et le passage vers le chœur des religieuses.
Maquette du sculpteur Pierre Székély pour la chapelle du carmel de Valenciennes et les bâtiments annexes. En haut, à gauche, l'entrée des religieuses qui sera reliée au cloître en construction, le clocher abritant l'avant-chœur, puis le passage vers le sanctuaire, et
le chœur où les stalles sont disposées en hémicycle face au mur courbe entourant l’autel. L’autre aile comprend d'abord, contre la chapelle, le pré-sanctuaire et le narthex, avec l'entrée extérieure, la nef et la tribune, où le public prend place les jours d’affluence.
Les couleurs de la chapelle, à l’intérieur, sont celles du costume des carmélites : sol brun foncé comme la bure des robes, murs blancs comme les manteaux de chœur et les voiles des novices, plafond de tôle noire au-dessus de l'autel, comme les scalaires et les voiles des mères professes.
Des orifices circulaires découpée dans le plafond, laissent passer la lumière du jour qui trace sur le mur des "fresques" mouvantes, variant selon la position du soleil. La chapelle est également illuminée d'en haut, le soir, grâce à des projecteurs placés sous le toit de verre.
L'autel vu du choeur des religieuses. Székély a réalisé lui-même le tabernacle et les différents éléments du mobilier
liturgique: le chandelier pascal, le lutrin,
la lampe du sanctuaire, en cristal étiré,
la croix processionnelle en bronze coulée
sur une surface de pierre. Il a sculpté aussi
la chaire en travaillant directement dans
la carrière de pierre, à Euville. Le plafond,
ici, est en lames de pin.
Le tabernacle a d'abord été taillé dans la pierre, puis fondu en bronze, et conserve ainsi, à l'extérieur, le grain du calcaire. L'intérieur, doré à la feuille, abrite le ciboire, dessiné également par Székély.
Sortant de la chapelle, les religieuses pénètrent dans l’avant-choeur, situé sous le clocher.
Dans le mur de dédicace qui relie la nef
au sanctuaire, on a inséré un portrait
de sainte Thérèse de Lisieux, au-dessus
d'un orifice laissant voir les fleurs du jardin
symbolisant la spiritualité de la sainte.
Cette image est l’agrandissement d ’une photographie authentique (prise vers 1890) :
la volonté de renouveler l'iconographie religieuse
traditionnelle aboutit parfois à
substituer aux sujétions de l'art sulpicien
celles des habitudes visuelles répandues
aujourd’hui par le cinéma, le pop’art
et la publicité...
Le chœur et le clocher vus de l’extérieur. Les différente volumes sont raccordés entre eux par d'étroits éléments vitrés qui laissent entrer la lumière du jour. Le soir lorsque les lampes sont allumées dans la chapelle, l'éclairage filtre à travers ces "fentes" et illumine les murs extérieurs.
Devant le mur circulaire du choeur,
le narthex et l'entrée des visiteurs; à droite
la tribune; au fond, la paroi également
courbe qui s'élève, derrière l ’autel, à la
même hauteur que le clocher. Ce mur
protège le toit vitré de la chapelle contre
la pluie et le vent. Les murs du choeur,du sanctuaire et de la tribune sont en brique,
matériau traditionnel dans la région pour
les bâtiments d'habitation, tandis que
les lieux de passage sont en béton banché.
L’ensemble a été simplement blanchi pour
unifier l’édifice tout en préservant la différenciation
des volumes et des «épidermes».